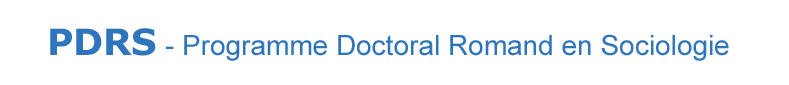Martine Zwick
Les exclus de l’insertion. Quand l’aide de passage devient permanente
Au cours des années 90, face aux difficultés rencontrées par les chômeurs en fin de droit et les bénéficiaires de l’aide sociale pour se (ré)insérer dans la société, des politiques d’insertion sociale et professionnelle ont été mises en place. Il ne fallait plus seulement prévenir, mais guérir les individus de leur manque d’intégration en les incitant à se responsabiliser et à s’activer afin d’être à nouveau intégrés à part entière dans la société. Cependant les mesures d’insertion montrent leurs limites, le mythe du « tout le monde est intégrable » s’effritant peu à peu. Le problème ne vient pas forcément des mesures et de leur application, mais plutôt du postulat sur lequel repose le dispositif, à savoir que chacun a des ressources et doit apprendre à les utiliser. Il faut se rendre à l’évidence : certaines personnes manquent cruellement de ressources et deviennent durablement dépendantes des services sociaux. Les mesures d’insertion ne sont pas à la portée de tous et créent une catégorie de personnes « non-intégrables ».
L’enjeu d’étudier cette catégorie des « exclus de l’insertion » est de partir du singulier « Que font-ils et que fait-on pour eux ? » pour comprendre le dispositif « Dans quelle mesure y a-t-il adaptation et transformation du travail social ? » afin finalement de découvrir quelles sont les incidences sur notre société et de saisir « Dans quelle mesure y a-t-il changement dans la façon de définir la solidarité, la cohésion sociale, le vivre-ensemble ? »
Mots-clés: politiques d’insertion, catégorisation, exclusion, ressources, solidarité
Directeur de thèse : Prof. Marc-Henry Soulet
Institution de rattachement : Université de Fribourg
Année d’inscription de la thèse : 2008
Soutenance prévue en (à titre indicatif): 2012